Dans ses Pariser Tagebücher, Jünger évoque à plusieurs reprises, par exemple le 11 octobre 1941 et le 7 avril 1942, ses rencontres avec Pierre Drieu La Rochelle, dans Paris occupée par l’armée allemande. Drieu est alors le rédacteur en chef de La Nouvelle Revue française, publiée aux éditions Gallimard. Le jeudi, Jünger fréquente souvent le salon littéraire de Florence Gould, où l’a introduit Gerhard Heller, et où il a fait la connaissance de Paul Léautaud, Henry de Montherlant, Marcel Jouhandeau, Alfred Fabre-Luce, Jean Schlumberger, Jean Cocteau, Paul Morand, Jean Giraudoux et bien d’autres. Plus tard, Jouhandeau se rappelera de lui comme d’«un homme très simple, très jeune d’allure, au visage délicat, et qui portait des vêtements civils, un noeud papillon» (1).

Le 16 novembre 1943, Jünger note dans son journal qu’il a revu Drieu La Rochelle à l’Institut allemand de Paris, alors dirigé par Karl Epting. Il dit avoir avec lui «échangé des coups de feu en 1915. C’était à côté du Godat, le village où est tombé Hermann Löns. Drieu, lui aussi, se souvenait de la cloche qui y sonnait les heures: nous l’avons entendue tous les deux». Bien des années plus tard, dans ses entretiens avec Antonio Gnoli et Franco Volpi, Jünger, devenu centenaire, évoquera à nouveau ce souvenir: «Quand nous nous rencontrions, nous parlions souvent de nos expériences de la Première Guerre mondiale: nous avions combattu dans la même zone du front, lui du côté français, moi du côté allemand, et nous entendions, sur des versants opposés, le son des cloches de la même église» (2). Il ne faut pas s’étonner que les deux hommes se soient d’emblée trouvés réunis autour du souvenir de la Grande Guerre. Elle les a tous deux marqués au plus profond, comme tant d’hommes de leur génération. Mais entre Jünger et Drieu La Rochelle, il y a bien d’autres points communs. Marqués profondément par la lecture de Nietzsche, tous deux, dans leur jeunesse, ont aspiré à une aventure africaine: Jünger s’est engagé dans la Légion étrangère, tandis que Drieu, en 1914, a demandé à être versé dans les tirailleurs marocains (expérience restée sans suite dans les deux cas). Tous deux, surtout, ont été– simultanément dans le cas de Drieu, successivement dans celui de Jünger – aussi bien des théoriciens politiques que des écrivains. Tous deux ont à bon droit pu être décrits, à un moment ou l’autre de leur vie, comme des «nationaux-révolutionnaires». Tous deux, enfin, ont incontestablement été des conservateurs révolutionnaires, désireux de sauvegarder des valeurs qu’ils jugeaient éternelles, mais en même conscients que l’avènement du monde moderne a créé des ruptures sur lesquelles on ne saurait revenir. Et cependant, beaucoup de choses les séparent.

Jünger a décrit la Première Guerre mondiale quasiment dans le feu de l’action, tandis que Drieu a attendu vingt ans pour rédiger La comédie de Charleroi. (En outre, ayant été réformé en 1939, il ne participera pas à la Deuxième Guerre mondiale). Dans la première des six nouvelles de ce livre, qui est certainement l’un de ses chefs-d’oeuvre, il évoque une charge menée contre les Allemands en 1914 dans la région de Charleroi. Cette description se fait dans le cadre d’une visite du champ de bataille, faite cinq ans plus tard par le narrateur en compagnie d’une riche bourgeoise, qui a elle-même perdu son fils dans ce combat. A vingt ans d’intervalle, on constate qu’au-delà de toute justification idéologique, Jünger et Drieu ont l’un et l’autre perçu d’abord la guerre comme une loi inhérente à la nature humaine, voire comme une réhabilitation de l’«homme naturel» dans la totalité de ses instincts. «C’est la vie, sous le plus terrible aspect que le créateur lui ait jamais donné», écrit Jünger (3). Pour Drieu comme pour Jünger, la guerre est d’abord ce qui libère du monde bourgeois et révèle l’homme à sa vérité.
Tous deux ont cependant mesuré aussi combien la Grande Guerre, commencée en 1914 comme une guerre classique, s’est transformée peu à peu en une guerre d’un type totalement nouveau: un déploiement de forces impersonnelles gigantesques, un «duel de machines si formidable qu’auprès de lui l’homme n’existe pour ainsi dire plus» (4). Mais l’avènement de la «guerre technique» a surtout provoqué l’horreur chez Drieu, qui y verra une «révolte maléfique de la matière asservie par l’homme», une véritable «boucherie industrielle», alors que chez Jünger elle a fait naître l’intuition d’un nouveau type humain, totalement opposé à celui du bourgeois: le Travailleur, dont le «réalisme héroïque» serait capable d’assurer la mise en mouvement (Mobilmachung) du monde. Pour Jünger, les «armées de machines» annoncent les «bataillons d’ouvriers», l’expérience de la guerre devant conférer à l’homme une disposition (Bereitschaft) à la «mobilisation totale», c’est-à-dire à une volonté de domination (Herrschaft) qui s’exprime par les moyens de la Technique. Drieu ne partage en rien cette vision à la fois optimiste et volontariste. Dans l’entre-deux-guerres, il s’opposera à une droite qui continue à prôner les anciennes «valeurs guerrières» sans réaliser que ces valeurs n’ont pas de pire ennemi que la guerre moderne. «La guerre militaire moderne est sur toute la ligne une abomination», dira-t-il encore en 1934 dans Socialisme fasciste. Loin d’annoncer l’avènement d’un homme nouveau, le règne de la Technique, selon lui, implique au contraire une dégradation de l’homme. Comme on le sait, c’est seulement par la suite, sous la double influence de Heidegger et de son frère, Friedrich Georg Jünger, que Jünger entreprendra vis-à-vis de la Technique et de son caractère «titanesque» une réflexion critique qui l’amènera à prolonger, mais avec plus de profondeur, la réaction purement instinctive de Drieu.
Après avoir servi sur le front, qui a été pour eux l’occasion d’une sorte d’expérience mystique, les deux écrivains ont néanmoins cru possible de prolonger les acquis de la vie guerrière dans la vie civile. «Nous saurons établir la paix comme nous avons mené la guerre», écrit Drieu dans son premier livre, un recueil de poèmes intitulé Interrogation. Jünger, lui, s’affirme à la même époque résolu à transformer la défaite militaire en une victoire civile. Cette résolution explique son engagement politique. Leur rapport à la politique n’est cependant pas le même. Dans les années 1920, Jünger s’est engagé dans les rangs des nationalistes pour exprimer des convictions qui l’embrasaient au plus profond. Drieu, lui, s’est engagé plutôt pour conjurer ses propres hésitations. L’auteur du Feu follet fait partie de ces hommes qui sont venus à la politique à partir de la philosophie, avec le besoin de trouver des incarnations concrètes à des idées correspondant à leur vision du monde. Plus qu’un acteur, il se veut un observateur. Durant la Grande Guerre, d’ailleurs, alors que Jünger s’engageait totalement dans les «orages d’acier», il n’a pris part aux combats que de manière intermittente, ce qui ne l’a pas empêché d’être blessé trois fois. A bien des égards, il est un dilettante. A propos de son Journal des années 1939-1945, qui ne fut publié qu’en 1992, on a même pu parler de son «indifférence à toute conviction idéologique profonde», de sa «versatilité» (Julien Hervier). Ce n’est pas inexact, mais il ne faudrait surtout pas voir dans cette attitude la moindre trace d’opportunisme. Germanophile mais anglomane, hanté par la décadence mais conscient que son oeuvre s’inscrit aussi dans un certain décadentisme, Drieu est un homme d’hésitations, de volte-faces, d’oscillations, ce qui traduit peut-être ses origines bourgeoises. On le voit bien dans ses relations avec les femmes. Auteur d’un beau roman intitulé L’homme couvert de femmes (1925), que l’on sait être largement autobiographique, Drieu aime les femmes, mais ne les aime pas pour elles-mêmes. Son donjuanisme, d’inspiration quasi platonicienne, s’articule autour du désir de séduire et de l’«idée folle de la beauté»:
«Impossible de m’attacher à une femme, impossible de m’abandonner à elle. Je n’en trouvais aucune assez belle. Assez belle intérieurement ou extérieurement» (5).
C’est pourquoi cet homme «couvert de femmes» n’est jamais sorti de la solitude. Il en est allé de même en politique: aucun régime politique ne pouvait le séduire totalement, tout comme aucune femme n’était assez «belle» pour lui. Mais c’est précisément parce qu’il attiré par un idéal inatteignable et perpétuellement partagé entre des impulsions contradictoires que Pierre Drieu La Rochelle n’a cessé de lutter contre ce qu’il considérait comme de fausses antinomies. Interrogation contient ce vers: «Et le rêve et l’action». La juxtaposition de ces deux mots traduit très exactement ce que, toute sa vie durant, il cherchera à réconcilier. Drieu veut réconcilier le rêve et l’action, comme il veut réconcilier l’âme et le corps, le monde de la guerre et celui de l’esprit. Il interprète l’histoire de l’Europe comme la lente montée de l’idéologie bourgeoise, qui a abouti à la rupture de l’équilibre entre l’âme et le corps et a jeté l’homme sous l’influence délétère de la vie dans les grandes villes. Sa grande affaire est la réconciliation de l’âme et du corps. Dans ses Notes pour comprendre le siècle (1941), il écrit: «L’homme nouveau part du corps, il sait que le corps est l’articulation de l’âme et que l’âme ne peut s’exprimer, se déployer, s’assurer que dans le corps».
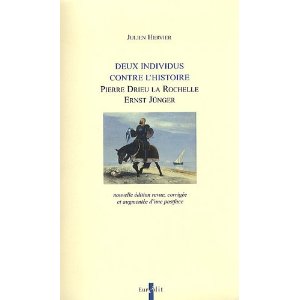 L’attitude de Drieu est celle d’un dandy. Or, beaucoup d’auteurs ont également vu en Jünger un représentant assez typique du dandysme. «Le dandy, écrit Nicolas Sombart, représente le type de celui qui se stylise lui-même […] Il a sublimé la volonté de puissance en une volonté de style […] S’efforçant de se styliser, il stylise le monde et a réalisé sa mission quand il a arrêté une situation dans une formulation élégante […] Pour cela, il doit s’astreindre à une autodiscipline, une abnégation et une ascèse rigoureuse» (6). «Distance, beauté, impassibilité, tels sont les éléments du dandysme jüngerien», écrit de son côté Julien Hervier (7). On songe ici à l’idéal d’«impersonnalité active» prôné par un autre dandy théoricien, l’Italien Julius Evola. Cependant, il y a plus de dandysme encore chez Drieu que chez Jünger, car le premier prône l’engagement pour l’engagement, comme d’autres ont pu parler de «l’art pour l’art». Drieu porte à l’histoire la même attention passionnée que Jünger porte à la botanique ou à l’entomologie. Mais pour lui, l’histoire est essentiellement fluctuante, gouvernée par le hasard, alors que Jünger s’emploie à y lire, derrière des apparences et des mouvements de surface, la «permanence harmonieuse d’un ordre stable» (Julien Hervier). Chez Jünger, l’histoire n’est jamais un phénomène purement humain. Elle relève plutôt d’une nécessité invisible, d’une sorte de métaphysique de la destinée, de forces qui la dépassent. C’est pourquoi Jünger ne s’intéresse pas tant à l’histoire qu’à ce qui est au-delà de l’histoire. C’est la raison de son intérêt pour les mythes.
L’attitude de Drieu est celle d’un dandy. Or, beaucoup d’auteurs ont également vu en Jünger un représentant assez typique du dandysme. «Le dandy, écrit Nicolas Sombart, représente le type de celui qui se stylise lui-même […] Il a sublimé la volonté de puissance en une volonté de style […] S’efforçant de se styliser, il stylise le monde et a réalisé sa mission quand il a arrêté une situation dans une formulation élégante […] Pour cela, il doit s’astreindre à une autodiscipline, une abnégation et une ascèse rigoureuse» (6). «Distance, beauté, impassibilité, tels sont les éléments du dandysme jüngerien», écrit de son côté Julien Hervier (7). On songe ici à l’idéal d’«impersonnalité active» prôné par un autre dandy théoricien, l’Italien Julius Evola. Cependant, il y a plus de dandysme encore chez Drieu que chez Jünger, car le premier prône l’engagement pour l’engagement, comme d’autres ont pu parler de «l’art pour l’art». Drieu porte à l’histoire la même attention passionnée que Jünger porte à la botanique ou à l’entomologie. Mais pour lui, l’histoire est essentiellement fluctuante, gouvernée par le hasard, alors que Jünger s’emploie à y lire, derrière des apparences et des mouvements de surface, la «permanence harmonieuse d’un ordre stable» (Julien Hervier). Chez Jünger, l’histoire n’est jamais un phénomène purement humain. Elle relève plutôt d’une nécessité invisible, d’une sorte de métaphysique de la destinée, de forces qui la dépassent. C’est pourquoi Jünger ne s’intéresse pas tant à l’histoire qu’à ce qui est au-delà de l’histoire. C’est la raison de son intérêt pour les mythes.
Drieu, qui a rêvé d’être prêtre ou moine, et qui, dans la préface de l’un de ses plus célèbres romans, Gilles (1939), écrit que si sa vie était à refaire, il la consacrerait à l’histoire des religions, porte lui aussi un intérêt passionné aux mythes. Comme Jünger, il se réfère par ailleurs constamment au sacré, mais sans jamais chercher à le rapporter à une religion particulière. Le sacré est pour lui synonyme de divin, et ce divin est plus immanent que transcendant. Déjà, pour décrire la brutale réalité de la Grande Guerre, il faisait appel au vocabulaire religieux. Lorsque les bombes éclataient, il s’exclamait: «Ce ne sont pas les hommes, c’est le Bon Dieu, le Bon Dieu lui-même, le Dur, le Brutal!» (La comédie de Charleroi). La guerre a été pour lui, tout comme la religion, une manière d’éprouver le sacré.
 Partout dans son oeuvre, le lien entre la vie soldatique et l’ascétisme, le lien entre l’action et la religion, est manifeste. Enfin, comme Jünger également, qui dit que le cosmos a pour lui une dimension divine et sacrée, il affirme que «la nature est animée, parlante, prodigieuse innombrablement». Jünger emploie rarement le mot «Dieu», qu’on trouve au contraire fréquemment chez Drieu. Mais, de l’affirmation de Nietzsche selon laquelle «Dieu est mort», il tire la conviction que «Dieu doit être conçu d’une nouvelle façon». Jünger s’est définitivement éloigné de la politique dès le début des années 1930, tandis que Drieu ne s’est est jamais détaché. Comme l’a bien noté Julien Hervier, la nécessité de l’engagement relève pour Drieu d’une éthique de l’action pour l’action. Sous l’Occupation, c’est ce souci de l’engagement pour le principe qui l’amène à continuer d’écrire des articles politiques alors que la politique ne l’intéresse plus guère. En lisant son journal, on voit bien que ses véritables préoccupations le portent plutôt vers la spiritualité orientale. Il va jusqu’à dire que la politique ne fut jamais pour lui «qu’un motif de curiosité et l’objet d’une spéculation lointaine» qui ne l’a jamais attiré que par «saccades» (8). Refusant le monde bourgeois et la démocratie, il ne cessera certes jamais de croire à la possibilité d’un socialisme non marxiste. Mais à sa façon, c’est-à-dire «par saccades», et non sans une certaine cécité sur la réalité des choses. Jünger s’est retiré de la politique parce qu’il a pris la pleine mesure de l’esprit «maurétanien», alors que Drieu, au contraire, a continué de s’engager parce qu’il pensait que dans la vie, il faut s’obliger à se salir les mains. En adoptant cette attitude, le dandy se sauve lui-même par rapport aux effondrements qu’il constate autour de lui. Quand la bataille est perdue, il ne reste que la beauté du geste.
Partout dans son oeuvre, le lien entre la vie soldatique et l’ascétisme, le lien entre l’action et la religion, est manifeste. Enfin, comme Jünger également, qui dit que le cosmos a pour lui une dimension divine et sacrée, il affirme que «la nature est animée, parlante, prodigieuse innombrablement». Jünger emploie rarement le mot «Dieu», qu’on trouve au contraire fréquemment chez Drieu. Mais, de l’affirmation de Nietzsche selon laquelle «Dieu est mort», il tire la conviction que «Dieu doit être conçu d’une nouvelle façon». Jünger s’est définitivement éloigné de la politique dès le début des années 1930, tandis que Drieu ne s’est est jamais détaché. Comme l’a bien noté Julien Hervier, la nécessité de l’engagement relève pour Drieu d’une éthique de l’action pour l’action. Sous l’Occupation, c’est ce souci de l’engagement pour le principe qui l’amène à continuer d’écrire des articles politiques alors que la politique ne l’intéresse plus guère. En lisant son journal, on voit bien que ses véritables préoccupations le portent plutôt vers la spiritualité orientale. Il va jusqu’à dire que la politique ne fut jamais pour lui «qu’un motif de curiosité et l’objet d’une spéculation lointaine» qui ne l’a jamais attiré que par «saccades» (8). Refusant le monde bourgeois et la démocratie, il ne cessera certes jamais de croire à la possibilité d’un socialisme non marxiste. Mais à sa façon, c’est-à-dire «par saccades», et non sans une certaine cécité sur la réalité des choses. Jünger s’est retiré de la politique parce qu’il a pris la pleine mesure de l’esprit «maurétanien», alors que Drieu, au contraire, a continué de s’engager parce qu’il pensait que dans la vie, il faut s’obliger à se salir les mains. En adoptant cette attitude, le dandy se sauve lui-même par rapport aux effondrements qu’il constate autour de lui. Quand la bataille est perdue, il ne reste que la beauté du geste.
A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Drieu a le sentiment d’assister à la fin d’un monde, à la fin d’une ère: «La France est finie […] Mais toutes les patries sont finies». Il faut cependant rappeler qu’il a constamment plaidé pour l’Europe. Dès 1931, il a publié un livre intitulé L’Europe contre les patries. En 1934, dans La comédie de Charleroi, il écrit: «Aujourd’hui, la France ou l’Allemagne, c’est trop petit». Jünger – qui a toujours été francophile, comme Drieu était germanophile – a lui aussi su prendre de la distance vis-à-vis des appartenances nationales étroites: Der Arbeiter pose déjà une problématique mondiale que l’on retrouvera après la guerre dans son essai sur l’Etat universel. Drieu, lui, rêve seulement d’une régénération. Comme Nietzsche, il pense que ce qui est en train de s’effondrer, il ne faut pas chercher à le sauver, mais au contraire accélérer son effondrement. Dans son journal, il déclare souhaiter la destruction de l’Occident et appeler de ses voeux une invasion barbare qui balaiera cette civilisation finissante: «C’est avec joie que je salue l’avènement de la Russie et du communisme. Ce sera atroce, atrocement destructeur» (9). A la même époque, il écrit aussi: «Je n’ai considéré le fascisme que comme une étape vers le communisme». Cette facilité avec laquelle il aura fait l’éloge du communisme stalinien aussi bien que du fascisme ou du national-socialisme, reportant sur le premier les espoirs trop vite déçus que lui avaient inspirés les seconds, ne surprendra que ceux qui ignorent tout du national-bolchevisme incarné par exemple par Ernst Niekisch, qui fut dans les années 1920 le très proche ami de Jünger. Dans sa jeunesse, sans doute précisément sous l’influence de Niekisch, Jünger a lui aussi vu dans les communistes les meilleurs préparateurs de la «révolution sans phrases» (10) qu’il célèbrera dans Der Arbeiter. Plus tard, mais dans une toute autre optique, il soulignera à quel point le communisme et le national-socialisme ont pareillement introduit la technique dans la vie politique, manifestant ainsi une même adhésion à la modernité, sous l’horizon d’une volonté de puissance que Heidegger a su démasquer comme simple «volonté de volonté». On trouve des réflexions analogues dans Genève ou Moscou (1928), où Drieu souligne que capitalisme et communisme sont tous les deux héritiers de la Machine: «L’un et l’autre sont les enfants ardents et sombres de l’industrie» (11).
 Cependant, Drieu est en même temps tenté par le retrait, par le passage à l’écart. L’un de ses derniers romans, L’homme à cheval (12), paru en 1943, raconte l’histoire d’un dictateur sud-américain, Jaime Torrijos, qui, après s’être emparé du pouvoir en Bolivie, a tenté de créer un empire. N’ayant pu y parvenir, il décide de se retirer à l’écart, ressuscitant les rites incas. Comme le héros de L’homme à cheval, Drieu a rêvé «de quelque chose de plus profond que la politique, ou plutôt de cette politique profonde et rare qui rejoint la poésie, la musique et, qui sait, peut-être la haute religion ». Mais il n’a pas su déterminer la voie qui le mènerait dans cette direction. Peut-être n’avait-il pas en lui les ressources qui lui auraient permis de devenir un Waldgänger ou un Anarque.
Cependant, Drieu est en même temps tenté par le retrait, par le passage à l’écart. L’un de ses derniers romans, L’homme à cheval (12), paru en 1943, raconte l’histoire d’un dictateur sud-américain, Jaime Torrijos, qui, après s’être emparé du pouvoir en Bolivie, a tenté de créer un empire. N’ayant pu y parvenir, il décide de se retirer à l’écart, ressuscitant les rites incas. Comme le héros de L’homme à cheval, Drieu a rêvé «de quelque chose de plus profond que la politique, ou plutôt de cette politique profonde et rare qui rejoint la poésie, la musique et, qui sait, peut-être la haute religion ». Mais il n’a pas su déterminer la voie qui le mènerait dans cette direction. Peut-être n’avait-il pas en lui les ressources qui lui auraient permis de devenir un Waldgänger ou un Anarque.
Jünger, lui aussi, a éprouvé le sentiment qu’une époque de l’histoire du monde s’achevait. Elle s’est achevée avec l’apparition du Travailleur, qui a inauguré le règne mondial de l’élémentaire. Les anciens dieux sont morts ou se sont enfuis, les nouveaux dieux sont encore à naître. Nous entrons dans l’ère des Titans. Pour prendre du champ, Jünger créera sucessivement la Figure (Gestalt) du Waldgänger, celui qui prend de la distance, puis celle de l’Anarque, celui qui prend de la hauteur. L’attitude de l’Anarque présente certaines analogies avec l’«apoliteia» prônée par Julius Evola. Mais cette Figure, tout comme celle du Waldgänger, pose clairement le problème de la place de l’individu par rapport aux grands processus historiques qui affectent le monde. Jünger évoque à cet égard «l’individu pris isolément, le grand Solitaire, capable de résister face aux situations difficiles pour l’esprit, comme celle qui s’annonce et qui sera un nouvel âge de fer» (13). On a pu parler de ce point de vue d’un «individualisme» jüngerien. L’individualisme de Jünger n’est certes pas l’individualisme hédoniste, qui reflète l’égoïsme et l’utilitarisme du monde bourgeois, mais plutôt l’affirmation des prérogatives de l’individu isolé (der Einzelne) qui sait reconnaître spontanément ses semblables. Chez Drieu La Rochelle, il y a en revanche des traces certaines de cet individualisme bourgeois, qu’il condamne pourtant avec énergie du point de vue historique, mais auquel il ne parvient pas toujours à échapper lui-même. La plupart de ses romans ne sont d’ailleurs que des histoires individuelles, et ses personnages sont bien souvent de simples émanations de lui-même. Aussi le rôle que les deux écrivains donnent à l’individu ou à l’élite n’est-il pas le même. Tandis que Drieu aspire à une nouvelle aristocratie politique, Jünger se situe à un plan plus élevé: l’entente spirituelle qui peut s’établir entre des hommes capables de dominer spirituellement leur temps.
Tout comme Henry de Montherlant, tout comme Yukio Mishima et tant d’autres, Pierre Drieu La Rochelle s’est finalement donné la mort. Mais on aurait tort d’expliquer son suicide par sa seule défaite politique, même s’il a lui-même incité à le faire en disant en substance: «J’ai joué, j’ai perdu, je réclame la mort». En fait, Drieu a été tenté par le suicide dès son enfance. Il avait écrit: «Quand j’étais adolescent, je me promettais de rester fidèle à la jeunesse: un jour, j’ai tâché de tenir parole». En se tuant, comme s’est tué le héros de son roman Le feu follet (14), Drieu reste fidèle à cette tentation de son enfance. Auparavant, il avait écrit dans son journal: «La beauté de mourir console d’avoir mal vécu. Dieu, qu’a été ma vie? Quelques femmes, la charge de Charleroi, quelques mots, la considération de quelques paysages, statues, tableaux, et c’est tout» (15). Ernst Jünger a écrit que «le suicide fait partie du capital de l’humanité», et c’est une maxime que Montherlant avait notée dans ses carnets lorsqu’il décida lui-même de se suicider, en septembre 1972. Jünger a vu aussi nombre de ses proches se donner la mort, notamment lors de l’attentat manqué de juillet 1944 contre Hitler (Hans von Kluge, Henrich von Stülpnagel) et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais le suicide reste pour lui une possibilité abstraite, négative en son essence, tandis que chez Drieu, pour qui la mort est le «secret de la vie», le suicide a une valeur mystique.
Le 7 septembre 1944, alors qu’il se trouve à Kirchhorst, Jünger apprend que Drieu vient de se donner la mort à Paris. «Il semble, écrit-il, qu’en vertu de quelque loi, ceux qui avaient des motifs nobles de cultiver l’amitié entre les peuples tombent sans rémission, tandis que les bas profiteurs s’en tirent». Dans ses entretiens avec Julien Hervier, il dira encore qu’il fut «très affligé» que Drieu «se soit suicidé dans un moment de désespoir». «Sa mort, ajoutera-t-il, m’a fait vraiment de la peine. C’était un homme qui avait beaucoup souffert. Il y a ainsi des gens qui éprouvent de l’amitié pour une certaine nation, comme il est arrivé à beaucoup de Français qui en éprouvaient pour nous, et à qui cela n’a pas porté chance» (16). Le 6 septembre 1992, il écrira à Julien Hervier: «Gallimard schickte mir Ihre Edition von Drieus Tagebüchern; die Lektüre hat mich bewegt. Die Kritik hat, soweit sie mir bekannt ist, die Bedeutung des Werkes nicht erfaßt. Ich habe mir für Siebzig verweht IV einige Notizen darüber gemacht, eine Copie anbei». Mots retenus. Entre ces deux hommes, il y eut de la fraternité.
* * *
Notes
1. «Mon ami Ernst Jünger», in Georges Laffly (Hg.), Hommage à Ernst Jünger, n° spécial de La Table ronde, Paris, hiver 1976, p. 9.
2. Les prochains Titans, Grasset, Paris 1998, p. 99. Trad. all.: Die kommenden Titanen. Gespräche, Karolinger, Wien-Leipzig 2002, trad. Peter Weiß.
3. Der Kampf als inneres Erlebnis, p. 244 de l’édition française.
4. Ibid., p. 243 de l’édition française.
5. Journal, Gallimard, Paris 1992, p. 512. L’homme couvert de femmes a été traduit en allemand: Der Frauenmann, Ullstein-Propyläen, Frankfurt/M. 1972, trad. Gerhard Heller.
6. «Le dandy dans sa maison forestière: remarques sur le cas Ernst Jünger», in Lettres actuelles, Paris, 9, novembre-décembre 1995, texte repris in Philippe Barthelet (Hg.), Ernst Jünger, Dossiers H, L’Age d’Homme, Lausanne 2000, p. 396.
7. Deux individus contre l’histoire: Drieu La Rochelle, Ernst Jünger, Klincksieck, Paris 1978, p. 86.
8. Journal, op. cit., pp. 437 et 309.
9. Ibid., p. 379.
10. Die Standarte, 23 novembre 1925.
11. Genève ou Moscou, Gallimard, Paris 1928, p. 131.
12. Der bolivianische Traum, Maschke-Hohenheim, Köln-Lövenich 1981, trad. Friedrich Griese.
13. Les prochains Titans, op. cit., p. 102.
14. Das Irrlicht, Ullstein-Propyläen, Frankfurt/M. 1968, trad. Gerhard Heller.
15. Journal, op. cit., p. 304.
16. Entretiens avec Ernst Jünger, Gallimard, Paris 1986, p. 127.
Marcelstloup
Merci pour cet article très complet sur ces deux auteurs que nous aimons particulièrement.